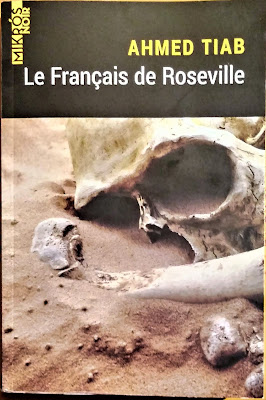Lu: «La Danse du Vilain», de Fiston Mwanza Mujila, éd. Métailié
C’était à l’époque du Zaïre et de la guerre civile en Angola où les diamants coulaient à flots pour ceux qui savaient saisir leur chance. Il sera question du personnage mythique de la Madone Tshiamuena, japonaise de naissance, environ, à l’âge environ également. Nous passerons dans les rues de Lubumbashi au Katanga et nous y resterons avec les gamins sans toit et avec pour unique loi celle de l’argent. Même si la corruption et la répression de l’État mène la vie dure aux habitants, la Danse du Vilain réconcilie tout un chacun au Mambo de la fête. Mais toute bonne dictature hélas a une fin et le Zaïre se fit RDC, la guerre remettant au passage les destins à zéro.
Ce roman est, encore une fois (il faut lire «Tram 83»!), extraordinaire. Chaque page contient un destin haut en couleur. Comment, mais comment l’auteur fait-il pour connaître tant d’histoires? Aussi, chaque phrase est criante de vérité. Certains écrivains, tu les vois venir de loin. Tu te dis: là, il exagère. Là, il veut m’en mettre plein les mirettes. Là, il se la joue grand auteur. Là, il fait son érudit. Mais pas Fiston Mwanza Mujila. Quand il te parle, tu l’écoutes. Attentivement. Il te raconte la vérité. C’est vrai, et les événements se sont passés tels que décrits. Je n’en doute pas une seconde. Je me disais, difficile de faire mieux que «Tram 83». Eh bien je me suis trompé. L’auteur ne fait pas mieux, il fait différent, il change de langue (vous connaissez beaucoup d’écrivains capables de changer de langue entre deux romans? Moi, non) et c’est encore un grand roman. Celui qui en fin de compte danse du début à la fin, c’est le lecteur. Chapeau, l’artiste. Toute mon admiration pour votre art.