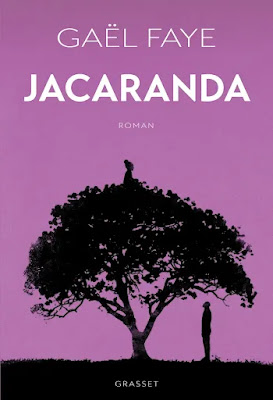Mon dernier livre intitulé « À la racine », journal-poèmes, publié aux édtions L'instant même, le 16 septembre 2025
Je suis allé le chercher chez l'éditeur, ici mon éditrice Geneviève Pigeon. D'habitude je fais le travail de correction avec Jean-Marie Lanlo, mais cette fois ce fut avec lui pour la sélection des textes et avec Geneviève pour la correction.
Voici ce qu'en dit mon éditeur:
Avec À la racine, la poésie devient l’écho du quotidien, saisissant ces moments fugaces qui, une fois couchés sur le papier, se révèlent être d’une profondeur insoupçonnée. Ce recueil prend la forme d’un journal-poèmes où chaque texte participe à une exploration plus vaste : celle du temps qui passe.
Sans suivre une ligne thématique rigide, À la racine propose une lecture en mouvement, où chaque poème trace une impression, esquisse une pensée, invite à une attention renouvelée au réel. Entre observations du quotidien et réflexions plus introspectives, le recueil d’Alain Raimbault laisse place à la sincérité d’une écriture qui privilégie l’instant plutôt que la démonstration.
Voici le texte du podcast ou balado que mon éditeur devrait publier fin août ou début septembre 2025:
1. Ton recueil s’ouvre sur une déclaration forte : “seule la poésie compte”. Qu’est-ce que représente la poésie pour toi aujourd’hui ? Et pourquoi était-ce la forme juste pour ce livre?
La poésie aujourd’hui n’est lue que par les poètes, à la limite par les romanciers, par quelques enseignants et par deux ou trois lectrices extraordinaires. C’est un genre très peu populaire, profondément personnel mais il compte parce qu’il dit ce qui est impossible à formuler, l’indicible. Si la philosophie essaye d’expliquer ou de questionner notre existence, d’arriver à des questions essentielles, la poésie, elle apporte des réponses. Elle est la seule forme littéraire capable de nous envoyer dans les étoiles l’espace d’un cillement. Là où la philosophie cherche et dit, la poésie trouve et montre. Du grand art. Elle nous offre plus que des réponses, elle nous montre la voie du bonheur. Elle est une respiration. Cette forme s’est imposée naturellement pour ce livre. J’ai simplement eu envie d’écrire de la poésie. Je suis aussi nouvelliste et romancier, entre guillemet parce que je suis en réalité un poète qui écrit des nouvelles et des romans. J’écris en fait uniquement de la poésie. Poète un jour, poète toujours. Formule facile mais vraie, je ne vais pas porter de masque.
2. Tu as choisi de construire ce livre comme un journal-poèmes, entre fragments du quotidien et réflexions intimes. Comment cette forme s’est-elle imposée à toi?
Pourquoi un journal? Je me suis dit qu’il serait intéressant de traduire en poésie des événements du quotidien, sans garder ce matériel littéraire, le journal, en vue d’écrire plus tard une fiction, comme cela m’arrive souvent. J’ai décidé d’exprimer sans recul l’explosion du monde, la brutalité du réel, le silence du moment. Tout prendre sans filtre et le traduire en poème. Aussi, je me suis tourné vers mes souvenirs car il est impossible de vivre à 100% dans le présent. Dans le flux de conscience, cette petite voix fatigante qui n’arrête pas de nous parler, j’ai extrait des images, je parle beaucoup en image dans ma tête, mais j’écris avec des mots. Ce qui est intéressant pour moi, c’est aussi l’abandon du surréalisme qui était mon genre d’expression favorite. J’écrivais de manière surréaliste, mais je constatais que j’étais très peu compris. Alors, après bien des années d'incompréhension, j’ai changé mon fusil d’épaule et j’ai décidé d’écrire dans une forme sous-réaliste, à six pieds en dessous du réel, et dans cet espace, j’ai la certitude d’être beaucoup mieux compris car il semblerait que vivrions sur Terre.
3. On croise dans ces pages des figures tutélaires : Charles Bukowski, John et Dan Fante, Raymond Carver... Que partages-tu avec ces écrivains du brut, de la marge, du quotidien et du désenchantement?.
Je vis au Canada anglais et français depuis 27 ans. Je suis toujours l’actualité littéraire de mon pays d’origine, la France, avec grand intérêt. J’ai découvert la littérature acadienne et québécoise parce que j’en fais partie, cette littérature est devenue mienne, intime. Le temps passant, et mon anglais s’améliorant aussi, je me suis peu à peu tourné vers des auteurs nord-américains. D'abord vers les romans de John Fante, dont “Ask the dust”, “Demande à la poussière”, qui m’a impressionné, ensuite vers les nouvelles de Raymond Carver, et de fil en aiguille j’en suis arrivé à la poésie de Bukowski. On classe ces écrivains dans le mouvement ou genre littéraire du Dirty realism, ou réalisme sale, ce qui pour moi est une insulte à leur art. Il n’y a rien de sale à leur littérature. Est-ce que Beaudelaire était un sale écrivain à cause des thèmes qu’il abordait? Non, ces écrivains m’ont appris l’abandon de toute flagornerie, de toute préciosité. Surtout, écrire vrai sans vouloir épater la galerie. Aller à l’essentiel, ne pas jouer à l’écrivain qui se regarde écrire ou au poète qui se regarde poéter. Non, pas du tout. Faire simple et direct, évoquer une expérience commune avec celle de la lectrice ou du lecteur. En tirer quelques images. Je ne pense partager ni l’alcoolisme suicidaire, ni le désenchantement de ces auteurs. Certes le monde est désespérant mais il est possible d’en tirer une phrase ou deux pour continuer à espérer. Je tente de voler à Bukowski la forme de ses poèmes mais je suis un piètre plagiaire car comment écrire en dehors de moi, hein? Comment m’oublier? Si Arthur Rimbaud à affirmé: Je est un autre, moi, je n’y parviens pas. N’est pas Rimbaud qui veut.
4. Tu dis que tu t’es “obligé à écrire trois poèmes par jour”, comme une discipline vitale. As-tu besoin de cette contrainte pour écrire ? Et comment sais-tu qu’un poème mérite d’être gardé?
Non, je n’ai besoin d’aucune contrainte pour écrire, au contraire. L’écriture me vient d’instinct, sans préparation. Je m’assois face à mon carnet ou à l’écran de l’ordinateur et je laisse venir. L’expression “trois poèmes par jour” me vient d’un documentaire mexicain sur un étudiant-ingénieur qui, pour réussir ses études, disait: je peux sortir danser, faire la fête mais quand je reviens à la maison, j’étudie “trois heures tous les soirs”. À la fin du documentaire, il reçoit fièrement son diplôme et travaille dans une station d’épuration des eaux usées de la ville de Mexico. Il vient de nulle part, il a travaillé fort et il est fier d’être le responsable des travaux d’une station d’épuration. J’ai juste changé les soirs en jours et les heures en poèmes. Je me compare beaucoup à cet ingénieur qui a réussi et qui répare. Moi aussi, quand j’écris, j’ai l’impression d’avoir réussi, et la publication de mes poèmes en livre est une forme de reconnaissance académique, de diplôme. Moi, qui ne viens de nulle part, je suis admis dans le vaste monde littéraire. Je répare aussi quelque chose, ou quelqu’un. Moi, peut-être. Pour ce qui est de savoir comment savoir si un poème mérite d’être gardé, il suffit d’attendre. Si le lendemain ou un mois plus tard je sens qu’il est bon, je le garde. Si je sens qu’il a perdu ses ailes, je le supprime. De toute manière, j’en écrirai un de bien meilleur demain.
5. Tu écris souvent en gardant à l’esprit ta fille, tes proches, ou même des lecteurs imaginaires. Est-ce que tu écris en pensant à qui te lira ? Quelle relation entretiens-tu avec le lecteur, dans un livre aussi personnel que celui-ci?
Je m’adresse effectivement à la personne qui me lit. Elle me lit toujours dans le présent, c’est la magie du texte écrit. Un livre est intemporel. Il parle toujours au présent, quel que soit ce présent. Oui, j’entretiens une relation serrée avec le lecteur parce que je lui parle de lui et il le sait. Il sait que ma poésie le concerne directement, comme une fable, une parabole, un accident. Je pense qu’il faut toujours tenir compte de la personne qui va nous lire pour la première fois, qui ne nous connaît pas et qui doit comprendre sans hésitation chaque mot, chaque sous-entendu. Une fois les vers compris, la magie opère peut-être et là, je n’y suis pour rien. J’offre le scénario, le lecteur l'interprète. À la fin, c’est toujours le lecteur le grand inventeur. Si la question est: pour qui j’écris? Ma réponse est: j’écris. Je ne peux savoir pour qui en particulier car le destin des livres est impénétrable. Dans le présent il y a mes proches, mes lectrices et mes lecteurs, mais dans le futur, ce présent de demain, il y a aussi un lectorat qui attend. Je les vois. Je ne les connaîtrais jamais. Je n’écris pas pour, j’écris avec. Avec la personne qui me lit. Nous écrivons ensemble, toujours, partout.
6. Que voudrais-tu que ce livre laisse au lecteur ou à la lectrice quand il ou elle le refermera? Une émotion, une lucidité, une voix?
Oui, une voix, une petite voix, une voix off sans mot, une voix de sous-titres. Et j’aimerais laisser des impressions. Des images utiles. Si ce livre ne laisse rien, il ne laisse rien dans la conscience, mais chaque texte lu nous transforme, chaque phrase entendue fait de nous une nouvelle personne, nous changeons presque d’identité. Quoi qu’il se passe, je sais que j’aurai semé une graine. J’aimerais que ce livre rapproche, qu’il laisse une sensation de proximité, de béatitude. Kerouac aimait bien le terme Beat Generation car beat se dit béat en français, synonyme de sérénité.
7. Pour finir, peux-tu nous lire un extrait de ton choix?
ces années à chercher le poème
à lire le livre
à croire au Père Noël
à vivre ici et là
feuille poussée par le vent
parmi les gens qui cherchent
l’argent
la paix
un travail raisonnable
une médaille
et ce que j’ai trouvé ne pourra jamais s’écrire
https://soundcloud.com/user-379196699/alain-raimbault-nous-parle-de-son-journal-poeme-a-la-racine
________________________________________________________________________
Voici l'avant-critique que Christian Dorsan a écrite pour le site ActuaLitté.com publiée le 19 août 2025
https://actualitte.com/article/125618/avant-critiques/a-la-racine-journal-intime-d-un-poete-entre-deux-rives
À la racine : journal intime d’un poète entre deux rives
La poésie puise son inspiration dans le quotidien… à condition de savoir la reconnaître. Depuis son Québec d’adoption, Alain Raimbault nous livre sous forme de journal intime, des bribes de sa vie, ses impressions, ses pensées, ses interrogations pour affronter le temps de la réalité.
Publié le : 19/08/2025 à 10:10
Cette réalité faite de conflit, de violence ou d’injustice s’oppose à son confort, à sa vie de famille, bien au chaud dans sa maison. La réalité est un inventaire à la Prévert dans lequel se mélangent futilités, tracas ou tragédies de l’actualité comme si l’horreur était mise sur le même plan que les autres, comme si le tragique faisait partie du quotidien.
De son origine, il garde une certaine nostalgie d’une enfance heureuse et innocente, une vie simple « mon village/mes pierres/mes lézards mes têtards mes couleuvres » qui contraste avec sa vie citadine « REM du matin/je remarque les chaussures/à la place des yeux/des passagers/des chaussures bien propres/bien cirées/bien lacées ».
Ses réflexions portent sur son identité de nomade car pour lui : « c’est rester qui m’angoisse », bientôt, il aura passé plus de temps au Québec qu’en France, ce qui le rend sensible aux questions des communautés autochtones dans lesquelles sa fille aînée aujourd’hui vit et travaille. Alors que reste-t-il de lui entre ces cultures ?
Un poète, un homme qui écrit, qui se penche sur ses contemporains, qui regarde les autres : « on recherche chez l’autre/des similitudes/des angles connus/un lumineux réconfort/une habitude/qui finiront par nous faire/pleurer de désespoir » et feuillette sa vie on comme on lit distraitement un magazine, s’attardant sur certaines photos, passant sur des articles.
Lire Alain Raimbault, c’est visiter un ami qu’on aurait perdu de vue, et qui nous explique son travail : « je tente de saisir l’instant/sans exagérer la description/ne pas tout donner/ne pas tout voler non plus », parle de ses passions : « quand je lis romans et poésie/le temps suspend son vol/seul le temps s’arrête/face à la beauté/l’unique promesse d’éternité ».
Heureux de le retrouver, il nous confie qu’il ne reviendra plus en France, et qu’il est sage de contempler le temps qui passe avec la mort au bout de la route : « pourquoi désirer l’éternité ? /vivre n’est pas assez difficile ? ».
Lire À la racine, c’est partager un peu la vie de cet exilé entre Québec et enfance, entre réalité et impressions, trouver ce qui nous révèle ou trahi dans le quotidien.
____________________________________________________________________
En octobre 2025, le journaliste littéraire Marc Sony Ricot et son photographe Lesly Dorcin sont venus chez moi pour enregistrer l'émission
Des fous et des dieux
Alain Raimbault, ce que la poésie retient du monde
Dans ce nouvel épisode de Des fous et des dieux, on reçoit Alain Raimbault, poète et écrivain. Il vient de publier À la racine, un journal-poème paru aux éditions L’Instant même.
C’est un livre intime, traversé par la vie, l’amour, la mémoire et cette lutte douce qu’est l’écriture. Une parole qui cherche à comprendre ce qui nous relie, ce qui nous fait tenir debout malgré les absences, les blessures, les jours qui passent.
Equipe du podcast
Présentation: Marc Sony Ricot
Réalisation: Ritzamarum Zétrenne & Marie-André Belange
Graphiste: Carlin Trézil
Photographe: Lesly Dorcin
Suivez-nous!
Facebook - Whatsapp
Hébergé par Ausha.
_____________________________________________________________________
Publié le 12 novembre 2025 Site D’Ailleurs poésie
Alain Raimbault : À la racine
par
Florent Toniello | 12.11.2025 |
Chroniques des recueils
« je m’oblige à écrire trois poèmes par jour / trois / ou plus / selon affinités / toujours une surprise de me relire le soir / et si je ne m’étais contraint à rien / je n’aurais pas écrit ce recueil / né d’un hasard forcé » : à mi-volume d’À la racine, Alain Raimbault lève le voile sur sa routine d’écriture, celle qui l’a conduit à rédiger l’ouvrage qu’on tient en main. Il enfoncera d’ailleurs le clou dans le tout dernier texte : « si je frappe Alzheimer un beau matin / ce sera la fin / la mort blanche / raison pour laquelle / chaque jour / trois poèmes ». Et pourtant, la routine de trois poèmes quotidiens (« après le silence / seule la poésie compte ») est bien la seule à laquelle il entend se soumettre. N’affirme-t-il pas que « le jour où nous recevons un salaire régulier / une large partie de notre cerveau / cesse de fonctionner / un œil se ferme / nous ne respirons plus qu’à moitié // l’argent est une épidémie dévastatrice / je le sais / je l’ai essayé », entre autres réflexions sur le sujet (écouter à ce propos également l’extrait audio) ?
Le mot est écrit : il s’agit bien là d’une poésie de réflexion, ancrée dans des bribes d’existence, faite de courtes narrations dans un langage simple (ce n’est pas un hasard si Bukowski revient plusieurs fois dans le livre et se voit citer en exergue). Le poète porte son regard acéré sur ces épisodes, les transformant en petites leçons de philosophie. La nostalgie de l’enfance (« je viens d’une jeunesse de garrigue / de fenouil et d’asperges sauvages / et je me demande bien chaque matin / ce que je fabrique / dans cette frigorifique Amérique / de série B »), la vie quotidienne actuelle fournissent leur lot d’histoires éclectiques ; celles-ci n’ont pas besoin d’être spectaculaires, puisque « y a toujours un auteur pour / raconter sa journée passée à regarder par la fenêtre / même quand personne ne passe ». Or une interrogation émerge : « l’écrit / de l’oral à rabais », « quand l’oral transmet depuis la nuit des temps / ces émotions indélébiles » ? Car Alain Raimbault nous entretient aussi de ses doutes, qui naissent paradoxalement de son rapport à la poésie : « pourquoi je suis pas simplement / plombier / une personne qui détient les outils pour / résoudre les problèmes / genre psychiatre des tuyaux / on m’aimerait pour quelque chose ». Eh oui, il faut « tant d’efforts / pour être lu ». Et le poète de nous raconter les manuscrits refusés, une éditrice enthousiaste qui ne rappelle jamais… « il manque une case / une sacrée case aux timbrés / qui donnent à lire leur je-me-moi / parce qu’après cette profanation / il leur reste quoi au juste ? » Le livre est là pourtant, avec ses mots simples en apparence, profonds dans leurs intentions. Même si « la poésie n’a jamais nourri les entrailles de personne / citez-moi un poète riche ? », l’argent n’est évidemment pas l’objectif.
Coincé dans les bouchons, l’auteur joue de malchance : « bien sûr les autres voies avançaient plus vite / que la mienne / et quand croyant bénéficier de l’élan / j’en changeais / immobilisation soudaine / mon ex-voie débarrassée de moi / se mettait alors à filer à un train d’enfer ». Il s’interroge devant sa télévision : « je me demande si les habitants de Gaza bombardée / lisent Mahmoud Darwich en ce mois de janvier / et quelle poésie naîtra des cendres ». Les souvenirs reviennent au gré des lectures : « par son journal / Anne Frank m’apprend que ma mère / est née un dimanche / jour de bombardements dans le nord d’Amsterdam / dimanche 18 juillet 1943 / je lis une époque / que je n’ai heureusement pas vécue / quelques jours plus tard / ma mère s’est fait tirer dessus à la mitraillette / dans la cour de la ferme / par les Allemands qui occupaient le village ». Alain Raimbault fait feu de tout bois, capte la poésie dans tous les événements qui l’entourent, l’ont entouré ou l’entoureront : « un jour / l’humanité fera un bond de géant / en remplaçant la voiture individuelle / par le cheval ». Avec générosité, il se met à nu dans un journal quasi intime pour partager une humanité, justement, qu’il importe encore de consigner par écrit : « la radio a été pour moi / mon ouverture sur le monde / me permet de tout imaginer / bonheur parfait / les écrans / ont créé la plus grande crise climatique / cérébrale / ils ont tout / asséché ». Coûte que coûte, pour faire face, la poésie avance dans ses pages. « tout est livre / (on se comprend) ».
ISBN 978-2-89873-037-5 (format papier)
_________________________________________________________________________
Vendredi 7 novembre 2025, je suis allé à l'Université de Montréal enregistrer l'émission...
Cette fin de semaine
Poésie par mots et par vaux reçoit le poète et romancier
Alain Raimbault.
Alain Raimbault a étudié l'espagnol à l’Université de Poitiers avant de devenir enseignant de Français en France, en Nouvelle-Écosse et maintenant dans une école secondaire publique de Montréal.
Nous discuterons autour de son dernier recueil intitulé À la racine, paru aux Éditions L'instant même, pour comprendre comment le journal-Poèmes gère l'épreuve de l'actualité.
Aussi pour comprendre de son livre la temporalité des faits, sa brièveté narrative, sa syntaxe obéissante et sa typologie instable.
Diffusion:
16 novembre 2025, midi,
CISM : 89.3,
Disponible sur Appel, Podcast et Spotify.
Présentation : Markendy Simon
Bonne écoute

Avec l'animateur Markendy Simon, qui m'a posé d'excellentes questions, c'était un vrai plaisir. Je ne connais pas le nom du monsieur qui a pris la photo.
L'émission a bien été diffusée Dimanche 16 novembre à midi
_______________________________________________________________________
7 décembre 2025
Article sur le site de Page par page
Alain Raimbault est un auteur, poète et enseignant. Il publie cet automne chez L’instant même un ouvrage hybride très intéressant : À la racine.
L’ouvrage est un journal où l’auteur écrit son quotidien, ses pensées et ses souvenirs. Cette incursion dans son univers nous invite dans la profondeur inattendue du quotidien. De Poitiers à Wolfville, de Phil Collins à Stephen King et de Zidane à son grand-père, Raimbault tergiverse tout en restant intéressant. C’est comme écouter un ami qui revient de voyage. Ce qu’il raconte est teinté à la fois de nostalgie et de regard vers le futur. Il y a quelque chose d’intemporel et de rassurant. C’est vraiment très doux à lire.
Les pages sont écrites en vers. Raimbault utilise la langue, légère et imagée, à son avantage pour agrémenter ses histoires. Je ne catégoriserais pas cet ouvrage comme un recueil de poèmes, puisque j’ai l’impression que l’auteur utilise la forme pour soutenir le fond. C’est un auteur assez talentueux pour utiliser les mots comme outils de précision et les vers sont un choix très judicieux.
À la racine est vraiment un bon livre à lire pour s’évader et réfléchir. Alain Raimbault n’a plus de preuve à faire et c’est très bien ainsi.
Auteur : Alain Raimbault
Éditions : L’instant même
Parution : 15 septembre 2025
Pages : 208 pages
Crédit photo : Patrice Sirois
source consultée ce 7 décembre 2025: https://pageparpage.com/a-la-racine/
__________________________________________________________________
Sur le site La Métropole . com dimanche 17 janvier 2026
https://lametropole.com/2026/01/17/alain-raimbault-a-la-racine/
Ricardo Langlois (Ricardo Langlois a été journaliste a Pop Rock. Il a gagné 2 fois le prix du meilleur journaliste. Il a travaillé en région notamment à la radio de Châteauguay. Il a écrit plus de 70 articles pour l'UQAM. Prix du meilleur réalisateur a CHOQ FM en 2006. Il a écrit plus de 300 articles pour Famille Rock. Il est l'auteur de 7 livres de poésie) vient de m'écrire une très belle critique:
Alain Rainbault
(jolie petite erreur sous mon nom)
Écrire son journal. C’est quelque chose que j’embrasse. D’une autre époque, je me souviens du journal de St-Denys Garneau en livre de poche. Raimbault écrit sur son monde. Écrire pour apprendre à mieux se connaître. Écrire pour se souvenir d’événements douloureux comme si on se confiait à un ami. Écrire baroque comme Marie Uguay.
Raimbault baroque
Marie Uguay a tellement bien écrit la vie. « Traverser la vie. Le désir est ce qui est écrit et les circonstances sont les paysages, les lieux, les visages de ce désir. » (1 ) Il raconte une tuerie à l’Université de Prague (p. 44 ). Il se rappelle son enfance. « J’avais sept ou huit ans j’étais éternel ». (p. 49 )
Il parle de lui entre 1982 et l’an 2000 :
« Quand mon texte est fini
Je l’envoie vivre ailleurs je l’exile
Son écriture meurt
Le destin des morts m’échappe
Compris » (p. 61 )
Topographie de l’être
« Notre destin est un jeu : faire survivre l’ignorance et les mythes trompeurs ou bien chercher la connaissance et le bonheur ». (2 )
Je lis des bribes de vie de l’auteur. Souvent je laisse mes livres ouverts sur la table du salon. Je lis Robert Lalonde et Hélène Dorion. J’enfourche ma bicyclette, je roule dans la sloche. J’ai des écrits du journal qui me reviennent. Voici un texte qui n’est pas banal.
« Pas de karma ni de chakra ni de
Résurrection
Dieu est une invention jubilatoire
Et le paradis un niveau intermédiaire
D’un jeu vidéo
Mon chat sait mieux que moi la réalité du moment ». (p. 75 )
Et je note celui-ci :
« Neruda n’écrivait pas de poèmes
Mais des livres de poèmes
J’ai longtemps réfléchi et je me suis rendu
Compte que Neruda, c’est moi ». (p. 101 )
La joie tranquille
J’écris doucement mes poèmes. Je reviens à votre livre sur votre vie. Vais-je encore dormir cette nuit ? Je veux continuer. Je rêve d’une écriture qui m’emporte. Nos vies sont souvent déformées. Je rêve d’une fête douce. Je vacille doucement. Vous évoquez l’image de Phil Collins, le chanteur du fabuleux groupe Genesis.
« Il est jeune
En forme
Au top
Magnifique
Indestructible
Puis, je le retrouve en 2019 sur une scène
Au Texas
Assis
Vieilli
Santé fragile
Voix approximative
Une étoile moribonde ». (p. 142 )
Il a vieilli trop vite. Il a eu deux carrières. Sa carrière solo et Genesis. Les tournées mondiales. Vos lecteurs-lectrices découvriront un auteur remarquable. Vous parlez de Bukowski (p. 156 ). Des bribes comme un album d’images.
Un dernier extrait qui décrit bien notre société.
« Les écrans ont créé la plus grande
Crise climatique
Cérébrale ils ont
Tout asséché ». (p. 174 )
Ce projet de journal poétique, c’est une manière de redire le monde. L’auteur reste lucide et c’est très beau.
Notes
- Marie Uguay, Journal, 54. Boréal Compact.
- Marie Uguay, p. 125.
Alain Raimbault écrit des romans pour la jeunesse, des recueils de poésie, des romans pour adulte. En 2006, il a obtenu le prix Grand-Pré pour l’ensemble de son œuvre.
____________________________________________________