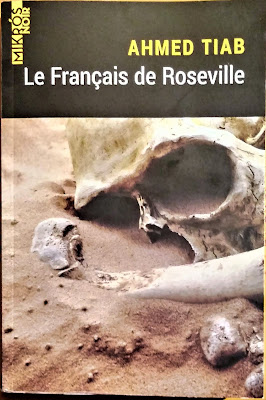Lu: «Soleil à coudre», de Jean D’Amérique, éd. Actes Sud
Rien ne va plus dans le quartier pauvre Cité de Dieu, à Port-au-Prince. Rien ne va jamais bien, d’ailleurs. Tête Fêlée n’a pas quinze ans. Sa mère, Fleur d’Orange, travaille aux corps pour survivre, trois réguliers, c’est mieux que le trottoir où les places sont chères. Son père officiel, surnommé Papa, aucun enfant connu, travaille pour le chef de gang de la cité. Il est son homme de main. Alors forcément, qu’elle le veuille ou non, Tête Fêlée doit rabattre le gibier pour son paternel. C’est comme ça la vie. Elle vous prend malgré vous, vous paralyse dans votre classe sociale (d’où personne ne sort). Mais il y aurait l’amour, peut-être, pour s’évader.
Ce superbe premier roman est celui d’un poète. Malgré l’histoire très dure, malgré la description d’un pays où règne la corruption, la loi du plus fort, la misère et la mort, où tous les coups sont bons pour survivre, le poète, dans un lyrisme surprenant, élève le débat. L’action, la réflexion est soudain grandiose. Page 45: «Je connais mes falaises, mes quartiers d’ombre. Je ne suis pas la moins nue sous le soleil des armes. Papa m’a beaucoup appris de la démarche du sang, de la valse du fer dans les territoires de la main.» Plus loin, page 56: «Par manque de caresses, nos corps s’adonnent au langage des décombres. Nos pas s’effacent dans les contrées de la vie, laissant la poussière se conjuguer.»
C’est un court mais dense roman, un long poème merveilleusement chanté. Parfois, je pense à la la Niña Estrellita (voir: «L’Espace d’un cillement», de Jacques S. Alexis) lorsqu'est évoqué le bordel à Port-au-Prince où Fleur d’Orange ne peut travailler. Je pense au très beau roman de Lyonel Trouillot intitulé «Bicentenaire» lorsqu'est évoquée la répression contre les manifestants. Je pense à tous les romans de Gary Victor quand il s’agit de corruption. Et à la verve de Frankétienne quand le poète (romancier ici, mais avant tout poète) se laisse aller, de même qu'au Jean-Claude Charles de «Manhattan Blues» pour le lyrisme. Très très beau roman, qui aurait plu à Baudelaire, c’est certain.

(Photos: Je lis souvent le matin dans l'autobus alors que je vais au travail. Ici, je suis dans l'autobus de la ligne 15, sur le nouveau pont Samuel de Champlain, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, entre chez moi à Greenfield Park et la station de métro Bonaventure, à Montréal, au Québec, en mai 2021, à la fin (je l'espère) de la pandémie de Covid. C'est pourquoi les passagers, comme moi, portons un masque.)